#LisezAvecMoi : Vol pour Arras, par Antoine de Saint-Exupry – Econlib
Antoine de Saint-Exupry (1900-1944) présente une dichotomie intéressante. Je parierais que la plupart des lecteurs de ces pages ont apprécié son charmant petit conte, Le petit Prince, dont environ 125 000 exemplaires sont vendus par an aux États-Unis (contre environ 300 000 en France). Ceux qui n’ont pas encore lu le petit livre en ont probablement entendu parler. Pourtant le reste de son œuvre est largement inconnue aux États-Unis (et, fait intéressant, en France, où chaque ville semble avoir une rue ou une école nommée en l’honneur de Saint-Exupry, dont le visage ornait le dernier billet de 50 francs français, avant le passage à l’euro).

Je me souviens avoir dévoré ses mémoires sur l’aviation quand j’étais à l’université. Courrier du Sud (1929), Vol de nuit (1931), Vent, sable et étoiles (1939), Vol pour Arras (1942), et Le petit Prince (1943), tous ont captivé mon imagination avec des histoires plus grandes que nature sur les premiers accidents de l’aviation, du désert et de la montagne, et des réflexions sur l’amitié et l’humanité. Comme ma mère française lorsqu’elle était adolescente (ce que j’ai découvert plus tard), je tenais un journal de citations, dont une bonne partie provenait de Saint-Exupry. Beaucoup venaient de Le petit Prince:
Et maintenant voici mon secret, un secret très simple : Ce n’est qu’avec le cœur qu’on peut voir juste ; ce qui est essentiel est invisible pour les yeux.
-Je cherche des amis. Qu’est-ce que cela signifie apprivoiser?
-C’est un acte trop souvent négligé, dit le renard. Cela signifie établir des liens.
-Pour établir des liens?
-Juste ça, dit le renard. Pour moi, tu n’es toujours rien de plus qu’un petit garçon qui ressemble à cent mille autres petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et toi, de ton côté, tu n’as pas besoin de moi. Pour toi je ne suis rien de plus qu’un renard comme cent mille autres renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Pour moi, tu seras unique au monde. Pour toi, je serai unique au monde….
Les grandes personnes ne comprennent jamais rien par elles-mêmes, et c’est ennuyeux pour les enfants d’être toujours et toujours en train de leur expliquer les choses.
Aimer, ce n’est pas se regarder, c’est regarder, ensemble, dans la même direction (de Vent, sable et étoiles).
Après avoir dévoré tous ses livres (à l’exception d’un roman posthume), j’ai en quelque sorte évolué. Lorsque ma mère enseignante indépendante de littérature française et de français langue étrangère décède subitement en 2007, je retrouve ses conférences sur Saint-Exupry. J’ai juré de les publier en tant qu’article académique co-écrit à titre posthume, mais j’étais alors professeur adjoint de première année, alors je me suis sagement concentré sur la rédaction des articles d’économie nécessaires à la titularisation et à la promotion, et j’ai mis le projet dans un tiroir.
Lorsque j’ai attrapé le COVID lors d’un séjour d’un mois à Paris en février 2022, j’ai décidé de revisiter le projet. je relis Vent, sable et étoiles avec des yeux d’adulte, puis a creusé la vie de Saint-Exupry, à travers une exposition sur la vie et des croquis de Saint-Exupry à la Musée des Arts Décoratifs à Paris, les mémoires écrites par son ami Lon Werth, et la magistrale biographie de Stacy Schiff (Saint Exupry : une biographie, Alfred A. Knopf, New York, 1994). Je me suis trouvé particulièrement intrigué par l’étrange exil de 28 mois de Saint-Exupry à New York, entre la chute de la France en 1940 et l’invasion alliée de l’Afrique du Nord en 1942. Je dédie ces réflexions à ma défunte mère.
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupry, est né à Lyon, en France, en 1900. Tenté par une carrière d’illustrateur ou d’architecte, il trouve sa vocation de pilote lorsqu’il est enrôlé dans l’armée en le nouveau domaine de l’aviation, en 1921. Il connaîtra par la suite une carrière de pilote de poste et de pilote d’essai, tout en écrivant et dessinant à côté. Sa première nouvelle fut publiée en 1926, et suivirent sa série de romans autobiographiques (et philosophiques) sur la vie dans les airs, et ses réflexions sur l’amitié, l’humanité et la vie, à partir de 30 000 pieds.
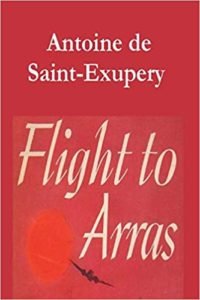
Vol pour Arras est le souvenir personnel de Saint-Exupry de la bataille de France, à laquelle il participa en tant que pilote dans un escadron de reconnaissance. Il utilise un vol particulier comme synecdoque pour sa participation à la bataille de France, la défaite désastreuse face à l’Allemagne nazie, et des réflexions sur la vie, le destin, la guerre, la mort et la ikigaï de piloter un avion. J’ai choisi ce livre car il préfigure la chute de la France et l’exil de guerre de Saint-Exupry à New York. Pour ce #ReadWithMe, j’utilise l’édition 2015, traduite par Lewis Galantire, et publiée par Martino Publishing (Mansfield Centre, CT).
Le livre s’ouvre sur le conseil du désespoir. Au milieu de la retraite de l’armée française en mai 1940, les escadrons d’observation sont largement en infériorité numérique. L’armée française entière ne comptait que 50 équipages d’observation de trois hommes. Sur les 23 équipages de l’escadre de Saint-Exupry, 17 avaient été décimés dans les trois premières semaines de la guerre. « Équipage après équipage était offert en sacrifice. C’était comme si on lançait des verres d’eau dans un feu de forêt dans l’espoir de l’éteindre » (14).
En tant que professeur, j’ai vécu l’absurdité de la bureaucratie universitaire : je me suis demandé un jour pourquoi nous perdions un temps précieux dans des réunions mensuelles de département qui auraient pu être un e-mail (et même cela aurait été exagéré) jusqu’à ce que je me rende compte qu’il y avait une réunion si le président du département pouvait signaler au doyen qu’il y avait eu une réunion à son tour, le doyen pouvait signaler au prévôt que tous les départements avaient tenu une réunion ce mois-là. En fin de compte, on enlève du temps à l’enseignement, à la recherche et à la substance, mais personne ne meurt.
Dans une déroute en temps de guerre, les choses sont différentes : « Ce n’est pas notre faute si nous ne nous sentons pas trop gais. Ce n’est pas la faute du major s’il est mal à l’aise avec nous. Ce n’est pas la faute du personnel s’il donne des ordres. Le major est mal en point parce que les ordres sont absurdes. Nous savons qu’ils sont absurdes ; mais le personnel le sait aussi bien que nous. Il donne des ordres parce que des ordres doivent être donnés. Donner des ordres est son métier, en temps de guerre » (18). Tout cela fait partie d’une danse meurtrière sur le théâtre de la guerre. « De beaux cavaliers transmettent les ordres ou plutôt, pour être moderne, des motards. Les ordres ordonnent des événements, changent la face du monde. Les beaux cavaliers sont comme les étoiles, ils apportent des nouvelles de l’avenir. Au milieu de l’agitation et du désespoir, des ordres arrivent, lancés aux troupes à dos de chevaux fumants. Et puis tout va bien au moins, dit le plan de guerre. Tout le monde se bat du mieux qu’il peut pour que la guerre ressemble à la guerre. Respecte pieusement les règles du jeu. Pour que la guerre soit peut-être assez bonne pour accepter de ressembler à la guerre » (ibid.). Des équipes d’observation sont envoyées jusqu’à une mort quasi certaine, et pour quoi faire ? « Sérieusement, les états-majors donnent des ordres qui n’atteignent jamais personne. Ils nous demandent des renseignements impossibles à fournir. Mais l’armée de l’air ne peut s’engager à expliquer la guerre aux états-majors. Bien sûr, ils tiennent compte de notre renseignement, puisque le plan de guerre exige que les officiers du renseignement fassent usage du renseignement. Mais même leur plan de guerre par plan s’était effondré. Nous savions parfaitement qu’ils ne pourraient heureusement jamais profiter de notre intelligence. Il pourrait être ramené par nous; mais il ne serait jamais transmis à l’état-major. Les routes seraient bloquées. Les lignes téléphoniques seraient coupées. Le personnel aurait déménagé à la hâte. L’information vraiment importante sur la position de l’ennemi aurait été fournie par l’ennemi lui-même » (19-20).
Toujours poète et mystique, formé par les Jésuites, Saint-Exupry traduit cette futilité en une belle expérience religieuse du désespoir. En attendant une autre mission absurde et dangereuse, il écrit : « J’étais momentanément comme un chrétien abandonné par la grâce. J’allais faire mon travail honorablement, c’était certain. Mais le faire comme on honore les anciens rites quand ils n’ont plus aucune signification. Quand le dieu qui les habitait s’en est retiré » (24). Alors qu’il se prépare pour la mission, il se lamente : « Je ne vois plus la cathédrale dans laquelle j’habite. Je m’habille pour le service d’un dieu mort » (33).
Et puis, quelque chose change. Le pilote, par son équipement, fait littéralement corps avec l’avion : « Je suis attaché à l’avion par un tube en caoutchouc aussi indispensable qu’un cordon ombilical. L’avion est branché sur la circulation de mon sang. Des organes se sont ajoutés à mon être, et ils semblent s’interposer entre moi et mon cœur » (38-39). « Je suis un organisme intégré au plan » (46). Bien que la mission puisse être futile, le pilote ikigaï est lourd de sens. « Pour moi, aux commandes de mon avion, le temps a cessé de couler stérile entre mes doigts. Maintenant, enfin, je suis installé dans ma fonction. Le temps n’est plus une chose en dehors de moi. J’ai arrêté de me projeter dans le futur. Je ne suis plus celui qui plongera peut-être dans le ciel dans un tourbillon de flammes. L’avenir n’est plus un fantôme obsédant, car à partir de ce moment je créerai moi-même l’avenir par mes propres actes successifs. Je suis celui qui vérifie le cap et tient la boussole à 313*. Qui contrôle les révolutions de l’hélice et la température de l’huile Ce sont des soins sains et immédiats. Ce sont les soins du ménage, les petits devoirs de la journée qui enlèvent le sentiment de vieillir. Le jour devient une maison brillamment propre, un parquet bien ciré, de l’oxygène prudemment distribué » (44). L’absurdité, la futilité et le désespoir de la salle de briefing ont fait place à la joie d’un métier bien exercé : « Il en est ressorti que j’exerçais mon métier. Tout ce que je ressentais, c’était le plaisir physique de passer par des gestes qui signifiaient quelque chose et étaient significatifs en eux-mêmes. Je n’avais conscience ni d’un grand danger (il en avait été autrement pendant que je m’habillais) ni d’accomplir un grand devoir » (48). Naturellement, Saint-Exupry revient alors au mysticisme : « A ce moment la bataille entre le nazi et l’Occident se réduisait à l’échelle de mon métier, de ma manipulation de certains interrupteurs, leviers, robinets. C’était comme il se doit. L’amour du sacristain pour son Dieu devient un amour pour allumer des bougies. Le sacristain traverse d’un pas délibéré une église dont il a à peine conscience, heureux de voir fleurir les chandeliers les uns après les autres sous l’effet de ses soins. Quand il les a tous allumés, il se frotte les mains. Il est fier de lui » (48-49).
Des questions
- Que dicte la philosophie morale dans une situation d’absurdité, de futilité et de danger ? Sommes-nous encore appelés à faire notre devoir et à y trouver un sens ? Faisons-nous confiance à la hiérarchie, à nos supérieurs et au « système » ? Ou est-il moralement permis de se dérober à un devoir futile ?
- Je me suis souvent demandé s’il y avait vraiment quelque chose de différent dans la Seconde Guerre mondiale ou si c’était mon parti pris parce qu’elle est plus récente ou parce que mes grands-parents français ont vécu l’Occupation de la France (1940-1944), et mon grand-père américain était officier dans les équipes de soutien de la Marine pour l’opération Torch et l’opération Neptune. Je me demande si, disons, la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale n’étaient que des luttes géopolitiques de grandes puissances encore une guerre, avec son horreur et son héroïsme, mais pas une lutte existentielle pour les valeurs occidentales. Saint-Exupry évoque « la bataille entre les nazis et l’Occident » (48)
Nikolai G. Wenzel est titulaire de la chaire LV Hackley pour l’étude du capitalisme et de la libre entreprise et professeur émérite d’économie au Broadwell College of Business and Economics de la Fayetteville State University (Fayetteville, Caroline du Nord).