En bref : les polices de responsabilité civile commerciale en France
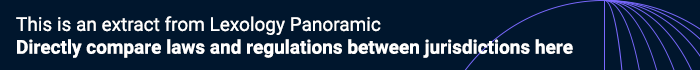
Polices de responsabilité civile commerciale standard
Blessures corporelles
Qu’est-ce qui constitue un préjudice corporel dans le cadre d’une police CGL standard ?
Le droit civil français et le droit des assurances définissent le préjudice corporel comme toute atteinte ou altération non désirée du corps d’une victime. Le préjudice corporel englobe le préjudice lui-même, mais aussi les préjudices financiers et non financiers qui suivent ce préjudice, qui sont évalués par référence à une nomenclature juridique non contraignante appelée « nomenclature Dintilhac », qui recense les types de préjudices que les victimes peuvent réclamer. à la suite de blessures corporelles : financières temporaires (par exemple, frais d’hôpital), financières permanentes (par exemple, perte permanente de revenus), non financières temporaires (par exemple, douleur et souffrance) et non financières permanentes (par exemple, handicaps). Par ailleurs, un préjudice moral peut également être invoqué du fait d’un préjudice corporel, tout comme les préjudices subis par les victimes indirectes (c’est-à-dire la famille de la victime).
Dommages à la propriété
Qu’est-ce qui constitue un dommage matériel dans le cadre d’un contrat CGL standard ?
Les polices CGL standard ont tendance à définir les dommages matériels comme un dommage ou une perte de biens corporels, d’objets, de substances ou d’animaux d’un tiers. Les pertes consécutives, telles qu’une perte de revenus ou une interruption d’activité, par exemple, ne seraient pas couvertes.
Occurrences
Qu’est-ce qui constitue un événement dans le cadre d’une police CGL standard ?
Les polices CGL régies par le droit français fonctionneront soit sur une base sinistre, soit sur une base sinistre. Dans une police d’assurance sinistre, la réclamation du tiers constitue l’événement. A l’inverse, dans un contrat sinistre, c’est la survenance du fait dommageable à l’origine du préjudice subi par le tiers qui constitue la survenance.
Comment est déterminé le nombre d’événements couverts ?
En France, les polices CGL prévoient généralement que chaque sinistre individuel constitue un événement distinct. Dans un tel cas, le montant total que l’assuré pourra recevoir au titre d’une succession d’indemnités pour plusieurs survenances du même risque au cours d’une période donnée dépendra : 1° de la franchise applicable à chaque survenance ; (2) les limites possibles de par occurrence ; et (3) une limite d’indemnisation totale pour le risque en cause. Certaines polices peuvent contenir des clauses de cumul de sinistres, selon lesquelles divers sinistres générés par une cause commune sont traités comme un seul événement, ce qui peut, compte tenu des faits d’une succession de sinistres donnée, être plus favorable à l’assuré ou à l’assureur. Compte tenu de l’impact financier que peuvent avoir les clauses de regroupement tant pour l’assuré que pour l’assureur, elles génèrent fréquemment des litiges de couverture.
Couverture
Quel(s) événement(s) déclenche(nt) une couverture d’assurance ?
Selon le type de contrat, la couverture sera déclenchée soit par un sinistre, soit par l’événement dommageable.
Comment la couverture d’assurance est-elle répartie entre plusieurs polices d’assurance ?
Le droit français des assurances étant construit sur le principe de l’indemnisation, il encadre une multiplicité de situations de garantie de telle sorte que l’assuré ne doit recevoir une indemnisation que pour le préjudice effectivement subi et ne doit pas réaliser de gain financier net du fait de sa réclamation pour le même dommage. perte dans le cadre de plusieurs polices.
Si donc l’assuré a souscrit de bonne foi plusieurs polices analogues ou qui se chevauchent, il n’y a pas de sanctions et l’assuré peut réclamer la totalité du sinistre à n’importe lequel de ses assureurs – et le droit français des assurances prévoit un mécanisme par lequel cet assureur devra, en ont à leur tour la possibilité de solliciter des contributions auprès des autres assureurs sur le risque. Si toutefois l’assuré a conclu plusieurs contrats d’assurance de manière frauduleuse (c’est-à-dire pour réaliser un profit financier en cas de sinistre assurable), les contrats en cause seront réputés nuls et non avenus et l’assuré pourra faire face à des demandes de dommages et intérêts.